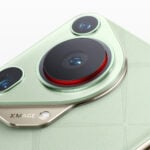01 DSI : A quoi jugez-vous la qualité d’un DSI ?Philippe Lemoine : J’adhère volontiers à la philosophie de Cisco, selon laquelle un projet informatique ne doit pas durer plus de trois mois, occuper plus de trois personnes et coûter plus de
300 000 dollars. C’est une excellente approche, car on n’oppose plus les stratèges à ceux qui réalisent. Et cela oblige à simplifier les cahiers des charges. Une chose est sûre : plus personne ne croit au DSI-Diafoirus [le médecin du
Malade imaginaire, NDLR], qui noie son action dans le discours technique. Après la fumisterie du passage à l’an 2000, où trop de DSI ont tiré la sonnette d’alarme comme s’il s’agissait d’un péril majeur, ceux-ci se doivent
de restaurer leur image. Et de faire en sorte d’être davantage du côté de l’innovation que de celui des soutiers. Il leur faut abandonner la seule vision de l’ingénieur. Et ils ne mériteront le titre de DSI que lorsqu’ils seront des vecteurs de
modernité pour leur entreprise ou leur organisation.Quel rôle peuvent jouer les DSI dans cette quête de l’innovation ?Ils doivent faire le lien entre l’envie de modernité que l’on retrouve dans toute communauté humaine et les réalisations nées de l’innovation. Les DSI devront lutter contre l’habitude bien française d’entretenir un discours
volontariste sur le futur : comme si l’innovation émanait forcément des équipes dirigeantes. Les technologies remettent en cause durablement les organisations pyramidales. Il revient donc aux DSI de savoir dénicher l’innovation technologique où
qu’elle se trouve. Mais toujours dans un esprit d’efficacité, et en pensant aux usages qui peuvent en être fait. Par exemple, on s’étonne que, hormis le cas de la déclaration de TVA en ligne, imposée aux entreprises par le ministère des Finances, la
signature électronique ne soit aujourd’hui que très peu utilisée. C’est un bon exemple d’un cas où le cadre juridique n’évolue pas au même rythme que les technologies. La solution technique existe, mais elle reste quasiment inemployée faute
d’usagers convaincus de son utilité ou de sa fiabilité. Autant de points sur lesquels les DSI peuvent faire entendre leur voix pour alimenter le débat.Pensez-vous que la réflexion sur la modernité soit aujourd’hui suffisamment consistante ?Non. Alors même que l’innovation a nourri, dans les années 70, en France, un débat qui agitait toute la sphère intellectuelle. A partir de l’année 1981, la réflexion sur cette question de la modernité s’est déplacée en
Allemagne avec des auteurs comme Ulrich Beck, qui aboutit à la conclusion que, souvent, la technologie relève plus du problème que de la solution. Il rappelle notamment qu’en inventant le bateau on a, en même temps, créé le naufrage…
Dans cet esprit, on peut se demander si le désormais sacro-saint principe de précaution ne conduit pas irrémédiablement à une certaine frilosité.Etes-vous satisfait de la place accordée aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les entreprises françaises ?En 2003, l’un des chevaux de bataille du Syntec Informatique est encore de démontrer à ses interlocuteurs que l’informatique peut représenter une source de productivité ! Il serait temps que les entreprises mènent une réflexion
en profondeur sur la contribution des technologies à la création de valeur. Aujourd’hui, le centre de gravité des TIC s’est déplacé. Nous sommes passés de l’informatique installée dans les usines et intervenant dans la production à celle présente
dans les bureaux, qui concerne la gestion. Et nous nous retrouvons désormais dans le monde de l’échange. Qu’il s’agisse de biens marchands ou non.Comment jugez-vous l’apport des années de la bulle internet à notre système économique ?De 1975 à 1995, le modèle stratégique de référence en matière économique était celui de la grande entreprise. Elle vendait 100 euros un produit, et, dix-huit mois plus tard, le commercialisait toujours au prix de
100 euros. Mais ledit produit comptait alors plus de fonctionnalités. Pendant cette période, les prix pratiqués par l’industrie ne connaissaient pas de baisse. On se contentait de restituer les gains de productivité en améliorant les capacités
des produits. Le risque était alors que le client ne trouve pas son intérêt dans cette innovation perpétuelle et qu’il la perçoive comme un déguisement marketing. Avec ce que l’on a appelé la ‘ nouvelle
économie ‘, le processus est inversé. On part du client final, qui cherche à ce qu’on lui facilite la vie et qu’on lui fasse gagner du temps. C’est plus que jamais le temps de la comparaison des prestations et des
prix.Quels sont, d’après vous, les aspects les plus négatifs de ces années start up ?Il y a, bien sûr, une part de gâchis. Due à l’inexpérience des jeunes pousses et à l’offre pléthorique de services, alors que le marché de l’équipement informatique des ménages et des entreprises était balbutiant encore. Les grands
groupes ont alors échoué faute d’une perception exacte du marché : ils ont oublié comment fonctionnait un client. L’inexpérience des jeunes entrepreneurs n’explique que 15 à 20 % du fiasco financier. Le reste est à mettre sur le compte de
quelques grands secteurs. Sans omettre les entreprises importantes, qui n’ont commencé à parler d’internet qu’à la fin de l’année 1999, soit deux mois avant l’éclatement de la bulle boursière.La diffusion croissante des technologies a-t-elle bouleversé notre organisation économique ?L’économie de l’après-e-krach est, aujourd’hui encore, pilotée par la déflation. C’est-à-dire que l’on recherche la compétitivité en pratiquant la course à la baisse des prix. Mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, le
modèle économique français n’est toujours pas devenu plus fluide. En effet, dans notre pays, le volume des stocks rapporté au produit intérieur brut (PIB) était d’environ 30 % en 1999, contre 25 % en 1945. On ne peut donc pas parler
d’économie immatérielle. Cette tendance est nettement moins marquée dans des Etats traditionnellement organisés en réseaux, comme le Japon (17 % en 1999) ou bien l’Allemagne (22 %). Le vrai bouleversement de l’économie par les TIC passe
par la gestion des stocks, car les technologies effacent la notion même de délai.Quels sont les exemples les plus frappants de l’apport des TIC ?Le constructeur et distributeur d’ordinateurs américain Dell dispose, en moyenne, de quatre jours de stocks ?” contre plusieurs dizaines pour Compaq ! Comme nous l’avons vu, le modèle issu de la nouvelle économie est
défini à partir du client final. Dell peut se permettre d’intégrer les innovations technologiques au fur et à mesure qu’elles sont disponibles. Compaq, lui, doit d’abord écouler les ordinateurs qu’il a déjà produits. Chez Amazon, le stock tourne
environ vingt fois par an : c’est énorme. En France, celui d’un hypermarché moyen connaît une rotation de l’ordre de dix et demi par an. Un rythme d’escargot au regard des pratiques du groupe Wal Mart, leader de distribution aux Etats-Unis,
dont les superstores ont un rythme de roulement du stock de vingt-cinq fois par an. L’explication en est simple : l’informatique est au c?”ur de leur programme de GRC et de leur processus de fabrication et de commande. Contrairement aux
Français, qui réfléchissent à ce qu’apportent les technologies en termes de réduction des coûts, ces entreprises américaines s’intéressent à leur impact sur leurs ventes et sur la rentabilité des capitaux engagés.Vous êtes à la tête d’un groupe de distribution. N’avez-vous pas perçu internet comme un danger pour votre métier ?Au contraire. Internet représente une formidable opportunité pour une forme de commerce riche en imaginaire, comme le sont les grands magasins. Pensez à un exemple encore plus saisissant : celui de la vente par correspondance.
Jusqu’ici, il fallait réaliser quelque 50 % de marge pour réussir à financer l’impression des catalogues, le coût des contacts clients et autres prises de commandes. Des activités d’aval qui finissaient par représenter 27 % du prix final
d’un produit, soit plus que la logistique ! Internet nous permet de réduire considérablement cette facture. Ceux qui sont en danger sont moins les commerçants que tous les professionnels installés autour des métiers de gestion de base de
données marketing. Ils se contentaient bien souvent de stocker des données sur le consommateur final, alors que ce qu’il faut désormais c’est savoir se plier à ses attentes.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.