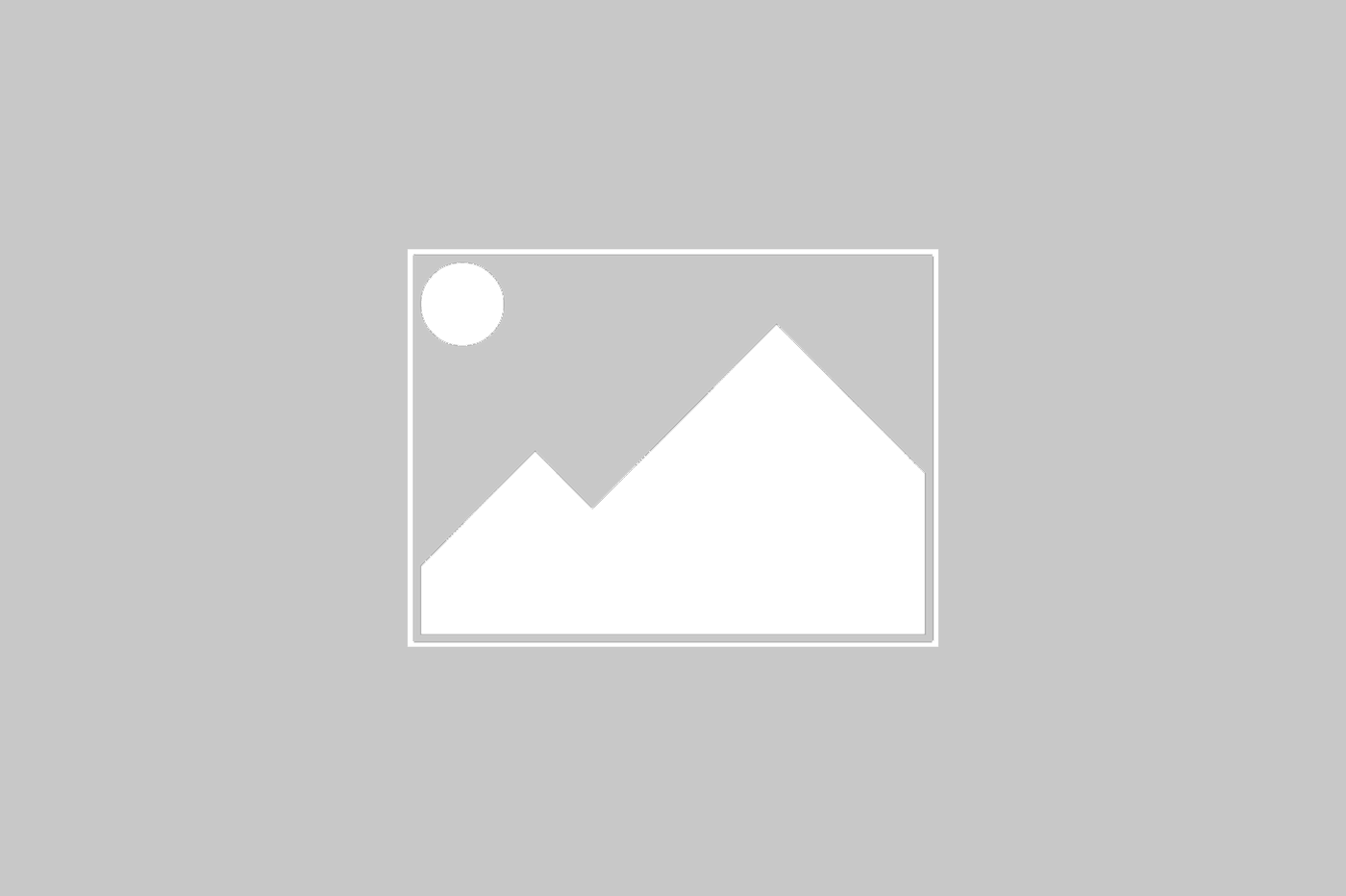Avant de poser la question de l’éventuelle nécessité d’une privatisation de France Telecom, interrogeons-nous sur sa faisabilité et sa finalité. En tant qu’exploitant d’un “service public national”, la Constitution de 1946 interdit la privatisation d’un groupe comme France Telecom. Le passage de l’État en dessous de 50 % impliquerait un changement de la Constitution. D’autre part, se pose le problème du statut de fonctionnaire de la majorité du personnel, nécessitant la mise en ?”uvre de procédure de type “détachement” sur longue période, avec un “droit au retour” dans la fonction publique qui reste à définir. Un tel projet remettrait donc en avant la question sociale dans un groupe où la conflictualité a nettement diminué depuis sa transformation en SA en 1996.Pourquoi la privatisation ? Nous partageons l’une des conclusions du rapport Larcher : une telle opération ne doit pas servir à renflouer le budget. En dehors de toute idéologie, la première question à se poser est donc de savoir en quoi la privatisation sert les intérêts des clients/usagers de l’entreprise France Telecom, de ses employés et de ses actionnaires. La seconde est de voir comment l’opération va également servir les intérêts industriels nationaux.
Un endettement colossal
Mais la croissance externe de l’entreprise, dont le but était de compenser les inéluctables pertes de parts de marché dans la téléphonie fixe en France par le développement des activités à l’international, a été réalisée au prix d’un endettement net colossal évalué à quelque 70 milliards d’euros. Cette dette est, d’une certaine façon, la conséquence du statut de l’opérateur public : la plupart des opérations d’envergure ont été réalisées en cash, dont 25 milliards de dollars (26,5 milliards d’euros) pour Orange. La procédure, plus classique, de l’échange d’actions, aurait entraîné le passage de l’État sous la barre des 50 %.Après le dégonflement de la bulle du secteur des télécommunications, les marchés financiers se sont focalisés sur la question de la dette, entraînant le cours du titre à ses plus bas historiques. La question d’un nouvel appel au marché a donc récemment ressurgi, l’objectif étant la réduction de la dette nette, afin que le groupe respecte ses engagements vis-à-vis de ses banques (respect d’un ratio dette nette/Ebitda). Dilutive pour les actionnaires de l’entreprise, et sur la base d’un prix qui ne refléterait en rien la valorisation réelle du groupe, une telle opération aurait le mérite de consolider la structure du bilan, d’apaiser les inquiétudes et d’enclencher un cycle vertueux pour l’opérateur.Mais rien n’indique que l’État puisse se soustraire à ses obligations d’actionnaire ?” rappelons-nous sur ce point le soutien récent du gouvernement néerlandais à KPN. De plus, la présence de l’État au capital constitue une assurance aux yeux des investisseurs, puisqu’elle garantit la dette. Dans le contexte que nous connaissons, un retrait de l’État aurait donc des conséquences graves en matière de financement de la dette, les obligations émises par l’entreprise cotant aujourd’hui avec un spread supérieur à 320 points de base par rapport aux emprunts du Trésor.Tous les grands opérateurs historiques du Vieux Continent sont aujourd’hui privatisés. Leur situation n’en est pas pour autant homogène si l’on considère la relative bonne santé de Telefonica ou de Telecom Italia, et les difficultés présentes de Deutsche Telekom ou de KPN. La privatisation de France Telecom ne doit donc pas s’inscrire dans un cadre dogmatique, mais bien dans un véritable projet pour l’entreprise et ses salariés, de même que pour la recherche d’une redynamisation de lindustrie française des télécommunications.*Chef économiste, Global Equities
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.