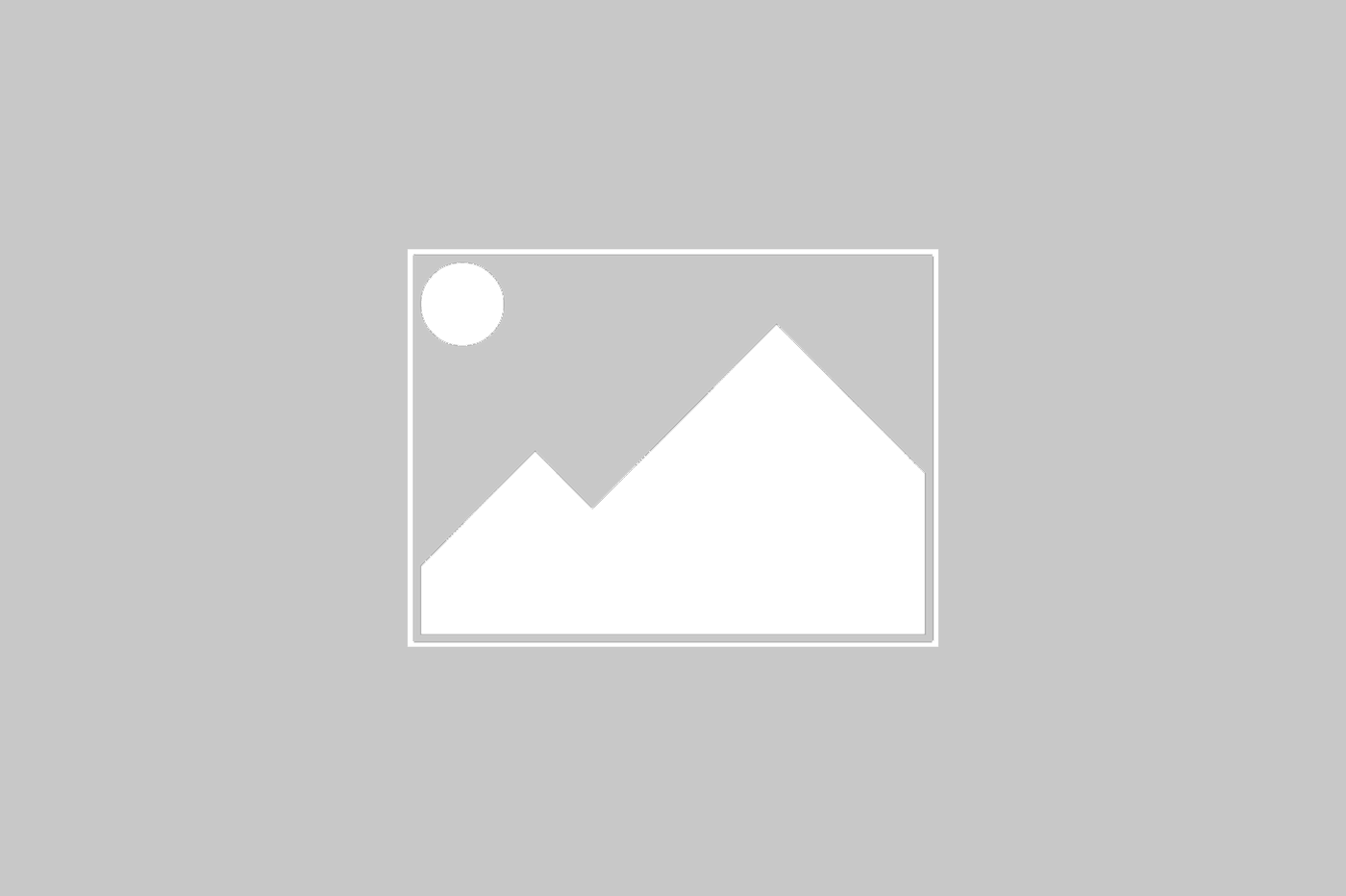L’ancien et le nouveau ont toujours cohabité de façon plus ou moins harmonieuse, et c’est heureux. Le tintamarre de la nouvelle économie avait cependant fait naître l’hypothèse que, par magie, le futur ne connaîtrait plus les dysfonctionnements du passé : plus de fluctuations, plus de crise, plus de récessions. Le pouvoir des nouvelles technologies de l’information et de la communication était tel qu’il allait même discipliner les organisations sociales que l’on appelle les marchés. Les chiffres invoqués à l’appui de cette thèse sont impressionnants : de 1992 à 2000, le taux de croissance annuel moyen aux États-Unis a été de 3,8 %, celui de l’investissement de 10 %. Tout cela sans inflation !
Une pareille performance aurait conduit à un taux de chômage proche de zéro en France, ainsi qu’à une augmentation significative, mais non inflationniste, des salaires. Autant le dire d’emblée : la fin des cycles est davantage de l’ordre du rêve que de l’analyse. Les marchés sont ce qu’ils sont, non pas des lieux de rationalité et de prévision raisonnée de l’avenir, mais des organisations humaines où les phénomènes de mimétisme, d’emballement, de désamour soudain joueront toujours un rôle majeur. Ni la marche chaotique actuelle ni l’augmentation glorieuse passée n’offrent une indication claire du long terme.
Effets favorables sur la Bourse
Les nouvelles technologies, elles, sont bien réelles, et la difficulté que nous avons à cerner leur effet ne signifie pas qu’elles n’en ont pas d’importants. Si elles devaient conduire à une élévation permanente du sentier de la productivité, alors, c’est vrai, elles sont porteuses de la meilleure nouvelle économique que le monde aura connue depuis au moins la fin des années 60. Une augmentation du rythme du progrès technique signifie, en effet, une élévation plus rapide des niveaux de vie, une augmentation de la rentabilité du capital, et de moindres tensions inflationnistes. On conçoit alors aisément que son effet sur les cours boursiers ne puisse être que favorable ?” aux sautes d’humeur près. Dans ce cas, le ralentissement américain ne serait qu’une péripétie normale, une phase conjoncturelle d’ajustement, au terme de laquelle l’économie repartirait sur un rythme aussi rapide que celui de la seconde moitié des années 90, et l’Europe serait au commencement d’une période de croissance d’autant plus vigoureuse qu’elle devrait rattraper son retard d’investissement sur les États-Unis. Mais cela impliquerait que la ” nouveauté ” appartienne au futur plutôt qu’au passé.L’une des raisons de l’importante diffusion des TIC (technologies de l’information et de la communication) aux États-Unis est que leur prix a considérablement baissé, ce qui a incité les autres secteurs à investir en ces technologies. Par exemple, le prix des ordinateurs ?” à qualité constante ?” diminue d’environ 28 % par an depuis 1995. Une telle évolution des prix est, bien sûr, la conséquence du progrès technique dans les industries productrices de ces technologies, mais elle peut en même temps refléter une rapide diminution de la productivité marginale de ces biens dans les secteurs utilisateurs. Robert Gordon a récemment soulevé cette hypothèse, en la fondant sur l’impression intuitive que chacun peut avoir que toute nouvelle génération d’ordinateur, quels que soient les perfectionnements qu’elle incorpore, n’ajoute pas vraiment grand-chose à la productivité de celui qui l’utilise.De même, pense-t-on vraiment que l’internet mobile va bouleverser les conditions de la productivité par rapport à l’internet fixe ? Si cette hypothèse était vraie, elle signifierait que l’essentiel des gains de productivité dus aux TIC appartient plutôt au passé : ils ont surtout été réalisés dans les années 90, au moment ou les micro-ordinateurs sont devenus d’usage courant (ou dans les années 90 avec internet) car, depuis, les améliorations successives apportées n’ont pas fondamentalement modifié les performances des utilisateurs.Mais les technologies ne valent que par leur appariement avec les hommes et les organisations. Il se peut que ce soit là que se trouvent les gisements les plus importants de productivité. Il faut du temps pour dominer une technologie ?” alors que beaucoup ont l’impression, aujourd’hui, d’être dominés par elle ?” pour réorganiser son travail (restructurer l’entreprise) afin d’en tirer le plus grand profit. Une étude a d’ailleurs montré que le paradoxe dit de Solow, énoncé au début des années 90 (“ On voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité “), pouvait s’expliquer parce qu’à l’époque, la proportion des entreprises qui s’étaient réorganisées autour des nouvelles technologies n’était pas suffisante pour aboutir effectivement à une augmentation de la productivité globale. Celles qui avaient acheté des ordinateurs sans se restructurer subissaient un coût supplémentaire et, donc, une perte d’efficacité. Ce n’est qu’à partir du moment où une majorité d’entreprises ont su intégrer les nouvelles technologies dans leur organisation du travail que leur effet sur la productivité de-vint visible, c’est-à-dire à partir de 1996.L’accoutumance à la technologie aurait, ainsi, des effets aussi importants sur la productivité que la technologie elle-même, mais ces effets ne se révéleraient qu’au fur et à mesure des relations ” réciproques ” de l’homme à la machine : l’apprentissage pour le premier, l’innovation pour être encore mieux adapté aux besoins, pour la seconde. Tout compte fait, il se peut que nous ne soyons encore qu’à l’aube de ce processus d’appariement, et que l’avenir soit encore devant nous ! Mais on perçoit que l’incertitude est plus grande qu’elle ne l’était il y a seulement une année, et qu’il est encore prématuré de parler de troisième révolution industrielle, comme certains l’ont fait.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.