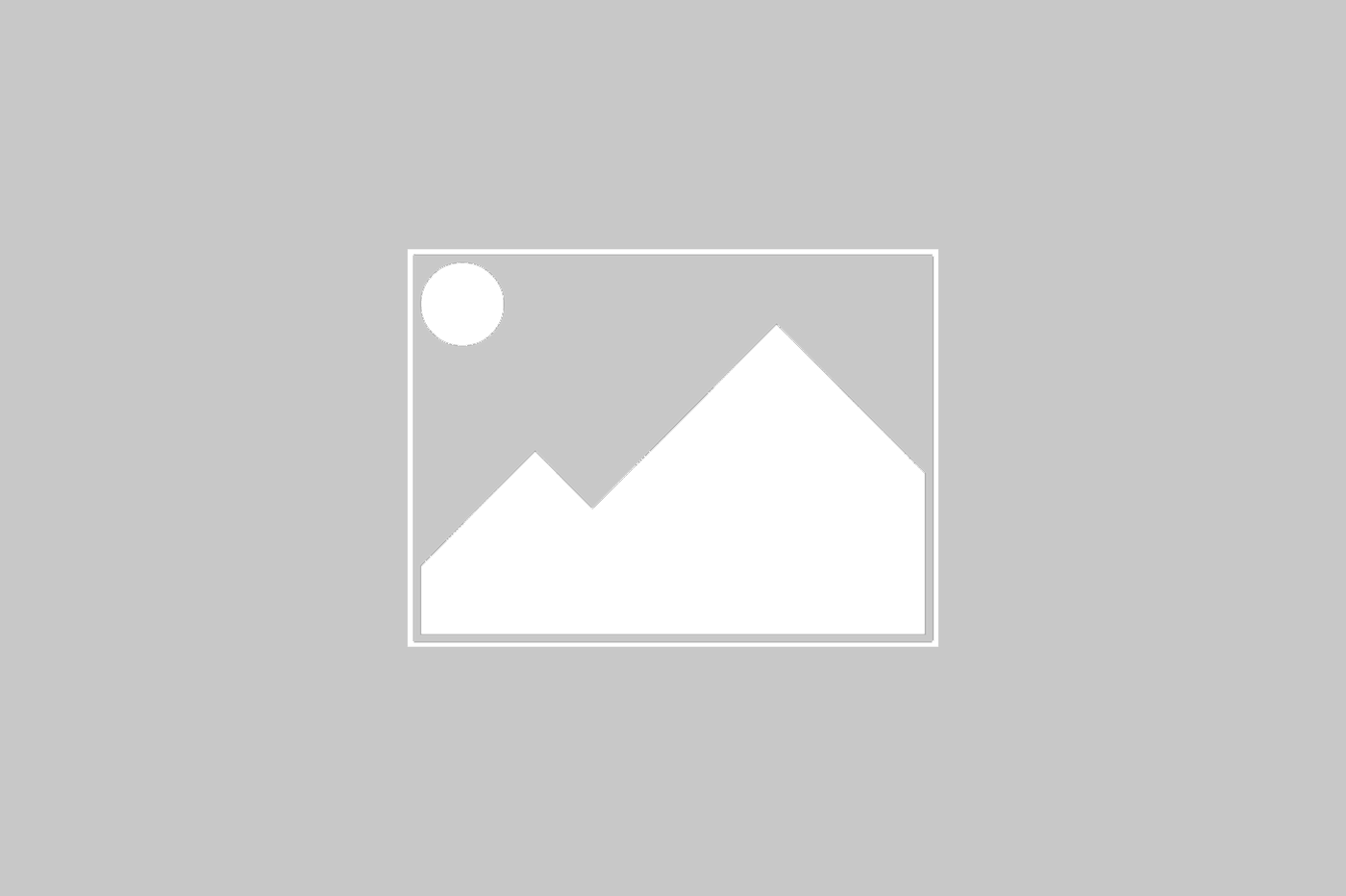Le thème des différences culturelles a suscité une multitude d’études et continue à nourrir les réflexions de bien des sociologues. Le problème est donc (relativement) bien connu. Et pourtant ! Il arrive encore que des directions des ressources humaines se laissent surprendre, comme l’illustre cette anecdote racontée par Olivier Barberot, DRH de Thomson Multimedia. “Dans le cadre de l’évaluation régulière de la performance de nos 10000 cadres, nous avions mis en ?”uvre un système de notation sous la forme de cotes chiffrées et d’appréciations verbales ?” ce que l’on appelle le “wording”. Les résultats chiffrés obtenus par les cadres américains et français de l’entreprise étaient globalement similaires. En revanche, le “wording” faisait apparaître que 80 % des cadres US auraient accompli un travail “remarquable”, alors que ce n’était le cas que pour 20 % des cadres français. Aux États-Unis, il faut être emphatique…” Conclusion : sur décision du comité exécutif, les appréciations verbales ont été supprimées du système d’évaluation.Qu’un même événement suscite des réactions très différentes de part et d’autre de l’Atlantique pose un défi permanent aux entreprises françaises TMT (technologies, médias, télécoms) décidées à se développer aux États-Unis. Dès la phase du recrutement. “Recruter là-bas est d’autant plus compliqué pour un Européen que leur façon de se vendre est très différente de la nôtre, confirme Bernard Liautaud, de Business Objects (BO). Aux États-Unis, un CV paraît toujours extraordinaire.” Plusieurs sociétés se sont laissé prendre à ce piège. Même les plus expérimentées… PDG d’Ilog, Pierre Haren reconnaît la difficulté : “Il faut bien comprendre qu’une boîte française moyenne suscite là-bas à peu près autant d’intérêt auprès des cadres américains de haut niveau qu’une boîte marocaine cherchant à recruter des ingénieurs en France. Dans un premier temps, il ne faut donc pas s’étonner de voir débarquer une frange de managers un peu aventuriers.” De son côté, Jean-Michel Gliner, le PDG de Silicomp, minimise le problème : “Nous avons mis des offres d’emploi sur internet, et n’avons pas eu de problème de recrutement.”Au passage ?” et ce n’est pas un détail ?”, les dirigeants français ont tout intérêt à ménager les éventuelles susceptibilités américaines en termes de pouvoir. “Lorsque Business Objects Inc. a été créée, raconte Bernard Liautaud, les cadres américains avaient un peu de mal à admettre qu’ils n’étaient “que” la filiale d’un groupe français.” Ce même souci de préserver les susceptibilités US perle chez Vivendi Universal. Par exemple quand Pierre Lescure, PDG de Canal Plus, qui passe une semaine par mois à Los Angeles, note dans Le Monde que “le cinéma américain continue à être fait par des Américains “.
Questions de complémentarité
Plus encore peut-être qu’en France, le succès d’une implantation aux États-Unis repose sur le recrutement de cadres américains de très grande qualité. On le comprend à la lumière de l’expérience décrite par Bernard Liautaud, qui n’envisageait pas un seul instant de faire monter BO au Nasdaq sans engager un directeur financier américain. “C’était indispensable”, dit-il. Bien sûr, les boîtes françaises du secteur TMT recourent abondamment à l’expatriation de cadres dirigeants. La vision de Jean-Michel Gliner résume assez bien la tendance : “Engager un management local pour prendre en charge tous les aspects liés au commercial, envoyer un cadre français pour transférer le savoir-faire technique et la connaissance des produits.” Certains, comme BO, accentuent le trait, ne gérant plus que la recherche et développement et la fabrication des produits en France. Question de complémentarité. Et puis, comme le répète volontiers Pierre Lescure, “s’il y a bien une chose que les Américains peuvent nous apprendre, c’est le marketing “.Et, peut-être, un certain rapport à l’argent. Habitué à aider les entreprises françaises à s’établir en Californie, l’avocat d’affaires François Laugier estime qu’“une différence fondamentale entre les Français et les Américains tient au rapport à l’argent : influencé par le système des grandes écoles, le Français envisage la qualité du produit avant de nourrir l’idée qu’il soit possible de le vendre. Pour l’Américain, c’est l’inverse.” De fait, Pierre Haren, PDG d’Ilog, clame que “les développeurs français sont les meilleurs du monde !” Et après ? Eh bien, il y a la pesanteur du système… Fred Cirera est l’un de ces développeurs qui font la fierté du système éducatif français. Il travaille actuellement pour Sun Microsystems, au c?”ur de la Silicon Valley. Et il n’est pas tendre pour certaines conceptions françaises dans les hautes technologies : “Aux États-Unis, dit-il, les gens ont une véritable considération pour le travail de développeur. En France, non. Tu fais deux ans de technique, puis il faut devenir manager, sinon, tu comptes pas. Mais moi, cette trajectoire ne m’intéresse pas. Je m’amuse comme un fou en faisant du développement. Et ici, aux États-Unis, quand on fait encore du développement à 35 ans, on ne passe pas pour un nase !”
” Ici, il faut être politiquement correct “
Pour autant, tout n’est pas rose dans la vie d’entreprise aux États-Unis. En termes de relations de travail, comme l’admet Fred Cirera, “ici, on balise “. Traduction : pas question de lâcher d’éventuelles gauloiseries à l’adresse d’une collègue. “Il faut être “PC” [prononcer “pi-siii”], ou politiquement correct. C’est marqué dans le guide que reçoit chaque employé.” Et Jean Pommier, vice-président Amériques d’Ilog d’ajouter, simplement : “On sent bien que le droit est différent ici.” Un “exilé technologique français” en Californie explique : “En dépit des vagues de licenciements auxquelles on assiste actuellement, j’ai l’impression que le mode de fonctionnement des relations professionnelles dans l’entreprise est moins sournois qu’en France, plus humain. Le mode de management me semble beaucoup plus transparent ici : grilles salariales, conditions de progression interne, régularité des entretiens d’évaluation, fixation claire des objectifs professionnels, etc. “. Accusée : la mentalité française, considérée comme trop étriquée.Le recours à l’expatriation permet non seulement de gérer les transferts de compétences de part et d’autre de l’Atlantique, mais a également pour effet d’élargir les horizons des entreprises “made in France “. Non sans susciter mille et un problèmes de gestion. Comment rémunérer les cadres expatriés ? Quid des plans de stock-options ? Quelle offre “expatriation” leur construire ? Quel accompagnement proposer à leur famille ? Comment maintenir un contact humain et professionnel performant avec 9 heures de décalage horaire ? Qui faire partir ? Et ainsi de suite. “Pour régler ces questions, nous avons établi une charte de la mobilité internationale, explique Evelyne Héno, DRH d’Ilog. Et ce document est accessible à chacun sur l’intranet de l’entreprise.” Ilog a notamment décidé que la rémunération de ses expatriés aux États-Unis serait adaptée au niveau de vie local. Mais les plans de stock-options, eux, sont gérés sur une base mondiale. Au sein des plus petites entités, en revanche, les plans d’expatriation sont rares ; on règle les problèmes au cas par cas.Les conséquences de la ruée vers l’Amérique ne se limitent évidemment pas à ces questions d’expatriation. On peut dire qu’elles imprègnent littéralement toute la société, même en France. “Il faut que les entreprises françaises soient conscientes qu’une présence aux États-Unis implique une transformation complète de leurs modes de fonctionnement”, insiste Bernard Liautaud, de BO. On le remarque notamment au niveau de l’emploi de la langue. “Toutes les réunions techniques se passent en anglais chez Ilog, indique Pierre Haren. Même chose pour les réunions du conseil d’administration. En revanche, les assemblées générales se tiennent en français, parce qu’aucun Américain n’y vient. Mais il ne faut pas en faire un fromage : dans l’Europe technologique, tout le monde parle anglais…” Et Ilog assume ce choix : “Nous investissons près de 3,5 % de la masse salariale en formation, précise Evelyne Héno, dont 40 % uniquement pour les cours de langue.” Chez Vivendi Universal, à en croire Catherine Gros, la directrice de la presse et des relations publiques, “toutes les réunions du conseil d’administration et des comités de direction sont traduites simultanément.”
Quand les Français pensent en anglais
Bien sûr, la diffusion croissante de l’anglais au sein même du monde de l’entreprise suscite des réactions, parfois virulentes, parfois cocasses. Comme ce “Prix de la carpette anglaise”, récemment attribué par des associations de défense du français à Jean-Marie Messier, pour stigmatiser la politique de Vivendi Universal qui consisterait à “favoriser systématiquement dans ses entreprises l’anglais comme langue de communication.” Messier rejoint notamment Martin Bouygues, accusé de diffuser des notes internes en anglais, Marc Lassus, ex-PDG de Gemplus, qui imposait à son personnel l’usage de l’anglo-américain en France, ou Serge Tchuruk, PDG d’Alcatel, montré du doigt pour avoir imposé l’anglais comme langue de travail à tout le groupe et ne laisser sortir aucune note de son bureau en français.Combat d’arrière-garde ? Sans doute, si l’on s’en tient à la réalité du terrain. “Beaucoup de sociétés françaises actives aux États-Unis rédigent leurs plans marketing en anglais, constatent Jane Woodward et Lorraine d’Huart, directrices de l’agence Akka. C’est une réalité. Mais, surtout, il nous semble de plus en plus évident qu’elles pensent désormais ces plans en anglais. Même chose pour la communication : on pense et on rédige en anglais, puis on traduit.” Par facilité : les concepts et termes les plus courants en management ou dans les technologies de l’information et de la communication émanent le plus souvent du monde anglo-saxon. Au risque de polluer la langue française d’un sabir parfois incompréhensible. Au risque, aussi, de pénaliser les cadres qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue de Shakespeare.Reste à savoir si la “nationalité” d’une entreprise a encore une importance au XXIe siècle. Pour Alain Tingaud, “aucun des projets de développement d’Infovista n’est imaginé sans une référence à San Francisco. Nous ne sommes plus du tout une boîte française en termes d’état d’esprit. D’ailleurs, nous sommes nés en France par accident.” Directeur de la communication de Schlumberger, Stephen Whittaker estime pour sa part que “la diversité culturelle est une source de richesse dans un groupe qui emploie 80 000 personnes et 200 nationalités “. De fait, seul compterait le talent des gens. C’est également le point de vue de Bernard Liautaud, pour qui “l’entreprise du futur doit devenir véritablement transnationale pour tirer le meilleur parti des talents quelle trouve dans le monde “. Pourvu que ce soit en anglais…Of course.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.