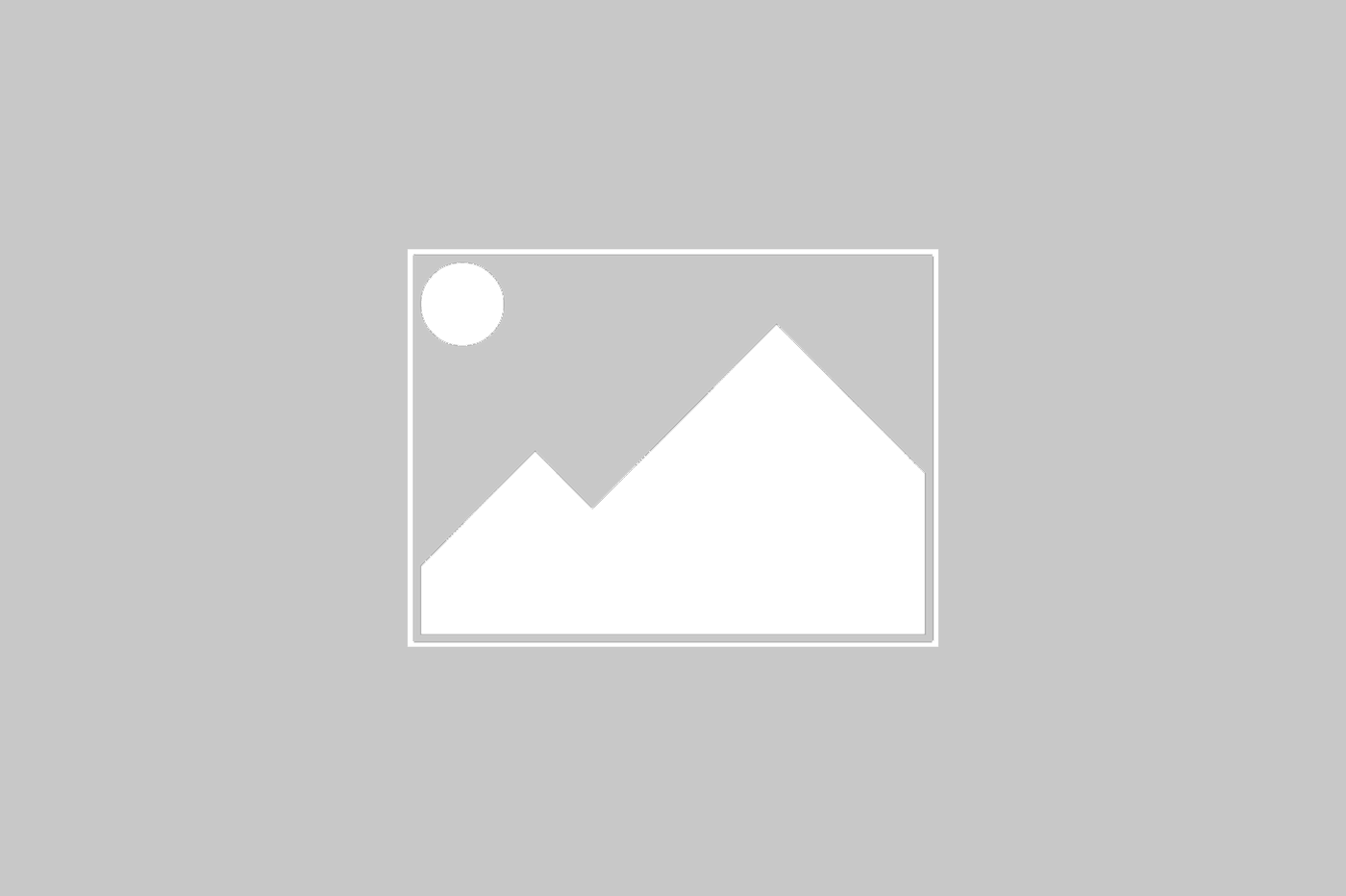Daniel LeBourhis, président du Meta Group, société de conseil et d’analyses en technologies de l’information, observe que les dirigeants d’entreprises s’intéressent davantage aux investissements technologiques. En terme de coûts et de stratégie. Comment analysez-vous le ralentissement économique ? Il n’y a pas eu de surinvestissement technologique en Europe, donc il n’y a aucune raison pour que nous connaissions un ajustement aussi brutal qu’aux États-Unis. La récession annoncée ?” et, dans ce domaine, les médias font preuve d’une certaine pugnacité ?” se fonde essentiellement sur des anticipations. Pour résumer : on est sûr que cela va arriver et, par conséquent, cela arrive. Le secteur high-tech reste un secteur à forte croissance. Même si les investissements portent davantage sur une réduction des coûts que sur un repositionnement à long terme, beaucoup de sociétés redéploient leur infrastructure informatique pour se développer dans le commerce électronique. C’est très sain car les entreprises ne peuvent faire le gros dos en attendant que ça se passe. Les turbulences économiques actuelles sont concomitantes d’un changement des règles concurrentielles.Quel est le niveau du surinvestissement technologique aux États-Unis ? Le rapport des investissements entre les États-Unis et l’Europe est de un à deux. Les entreprises européennes et, en particulier, les entreprises françaises, ont été plus prudentes sur certains investissements, comme dans l’ERP [progiciels de gestion intégrés, ndlr]. C’est dû en partie à la plus petite taille des entreprises et à la croissance soutenue outre-Atlantique. Le problème, c’est que les Américains investissent comme ils restructurent, c’est-à-dire très brutalement. En Europe, l’évolution est progressive, mais on observe qu’une partie croissante des dépenses en systèmes d’information n’est plus effectuée par les directeurs des services informatiques [DSI]. Elles proviennent de plus en plus des directions opérationnelles, comme le marketing ou les ventes, plus proches des mécanismes de formation des coûts. Nous ne devrions plus voir non plus de grands projets informatiques supérieurs à 12 mois. Quelle que soit la phase économique que nous traversions, la capacité d’adaptation est la première qualité d’un système d’information. Quel jugement portez-vous sur la volonté de Serge Tchuruk de transformer Alcatel en entreprise sans usine ? Les entreprises françaises ne disposent pas de la même latitude au plan social que les entreprises nord-américaines. Il est plus facile de faire un plan social en revendant des usines qu’en licenciant des salariés. En matière de stratégie “fabless“, Serge Tchuruk n’a rien inventé. Dans le secteur électronique, la création de valeur se fait en amont, avec les technologies et dans les brevets, et en aval, avec le service client. Entre les deux, l’entreprise fabrique si elle ne peut faire autrement. IBM n’a encore trouvé personne pour produire mieux et moins cher des AS 400. Mais la société n’est plus un constructeur d’ordinateurs : elle est devenue un monstre de services et une gigantesque direction de R&D.; Reste que la compétitivité d’Alcatel passe d’abord par l’acceptation de ses technologies par le marché et non par sa stratégie d’entreprise sans usine. Quels sont les process et les technologies qui vont être privilégiés dans cette période d’incertitude économique ? Le “buy & supply” devrait prendre le pas sur le “sell & services“. C’est-à-dire la mise en ?”uvre d’une fonction logistique au meilleur coût, plutôt qu’un développement des ventes. Dans le secteur de l’exploitation, pour les mêmes raisons que le “fabless“, nous allons assister à une montée en puissance de l’infogérance. Mais, les entreprises doivent garder le contrôle sur la définition et le design des systèmes : paramétrer un SAP reste porteur de valeur. Dans les technologies, on voit des standards émerger, comme le XML. Mais la question des investissements technologiques ne se pose plus en ces termes. Les choix sont devenus moins critiques : on ne se demande plus quel fournisseur de bases de données choisir. Les interrogations tournent autour de l’adaptation de ce choix aux évolutions de l’entreprise. Plus aucune décision technologique ne peut être prise sans une très bonne compréhension du business. Le DSI doit faire partie du comité de direction pour être au fait de la stratégie de l’entreprise dès sa préparation. Découvrir la stratégie au moment où il faut automatiser tel processus, c’est déjà trop tard. L’état de frilosité économique ne signifie pas que les entreprises ne vont plus investir. L’e-commerce a provoqué un regain d’intérêt des présidents d’entreprises pour la technologie. Ils y voient un élément de compétitivité, mais aussi un gros risque si cela ne marche pas. En outre, les DSI ne sont pas toujours préparés pour communiquer sur la création de valeur. Or, les systèmes d’information qui ne sont pas décrits à l’aune de la création de valeur sont perçus comme facteur de coûts. L’enjeu, pour les DSI, c’est de parler la langue de leur client, en l’occurrence celle du conseil d’administration,et d’être en contact permanent avec les directions opérationnelles pour pouvoir restituer les enjeux, en terme, par exemple, de clients perdus ou gagnés.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.